
 La Licence professionnelle Protection et valorisation du patrimoine historique et culturel convie chercheurs, auteurs, professionnels du territoire et étudiants à son 6ᵉ colloque, le 10 mai 2023 à partir de 14 h à l'Université d’Évry (amphithéâtre B6, bâtiment 1ers Cycles, 15 rue André Lalande).
La Licence professionnelle Protection et valorisation du patrimoine historique et culturel convie chercheurs, auteurs, professionnels du territoire et étudiants à son 6ᵉ colloque, le 10 mai 2023 à partir de 14 h à l'Université d’Évry (amphithéâtre B6, bâtiment 1ers Cycles, 15 rue André Lalande).
"Nos châteaux ont du talent. L'importance patrimoniale des châteaux dans l'attrait touristique dans le sud de l'Ile-de-France" est le thème retenu cette année.
Les châteaux s'associent à l'histoire en France : d'un témoignage historique majeur ou d'une fiction artistique, d'un repère géographique à la valorisation touristique, leurs présences accompagnent notre pays et sa représentation. Depuis le XIXe siècle et l’avènement du tourisme, ils sont aussi devenus des lieux importants économiquement (de la gestion d’un domaine à la gestion d’un château, des financements publics pour des propriétés privées aux métiers de la médiation et de l'accueil) et culturellement. On y organise des événements collectifs et des visites sous des formes innovantes. Ils sont aussi, entre modernité et tradition, dans un modèle économique fragile. Leur proximité peut devenir un vrai atout à l'avenir.
Sont invités Jean-Michel Tobelem, professeur associé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Frédéric Gatineau, président de la SHAEH (Société historique et archéologique de l'Essonne et du Hurepoix) et Fabrice Cotté, directeur de l’Office de tourisme Grand Paris Sud.
► Plus d'information ici.
► Dans la continuité du colloque, explorez cette sélection de ressources de la BU sur la valorisation touristique des châteaux, de la culture et du patrimoine et sur l'histoire des châteaux.
 La vie des châteaux : mise en valeur et exploitation des châteaux privés dans la France contemporaine stratégies d'adaptation et de reconversion par
La vie des châteaux : mise en valeur et exploitation des châteaux privés dans la France contemporaine stratégies d'adaptation et de reconversion par 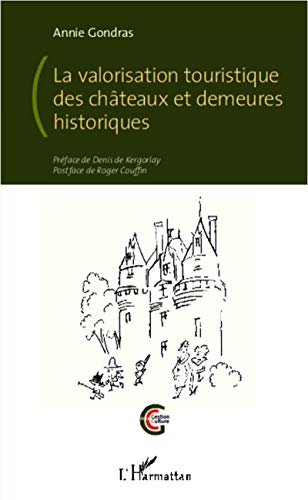 La valorisation touristique des châteaux et demeures historiques par
La valorisation touristique des châteaux et demeures historiques par  Valoriser et animer le patrimoine de proximité : guide méthodologique par
Valoriser et animer le patrimoine de proximité : guide méthodologique par 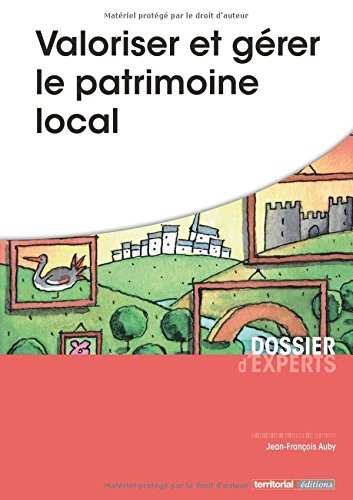 Valoriser et gérer le patrimoine local par
Valoriser et gérer le patrimoine local par  Économie des arts et de la culture par François Mairesse et Fabrice Rochelandet. Armand Colin, 2015
Économie des arts et de la culture par François Mairesse et Fabrice Rochelandet. Armand Colin, 2015 Géographie du tourisme et des loisirs : dynamiques, acteurs, territoires par
Géographie du tourisme et des loisirs : dynamiques, acteurs, territoires par  La médiation culturelle par
La médiation culturelle par 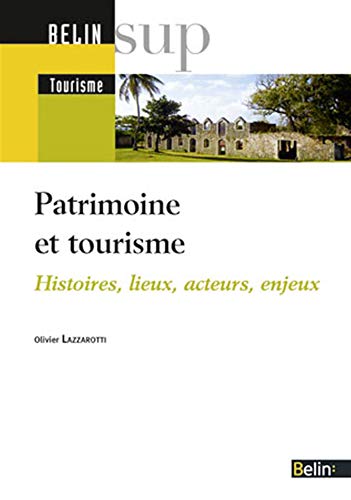 Patrimoine et tourisme : histoire, lieux, acteurs, enjeux par
Patrimoine et tourisme : histoire, lieux, acteurs, enjeux par 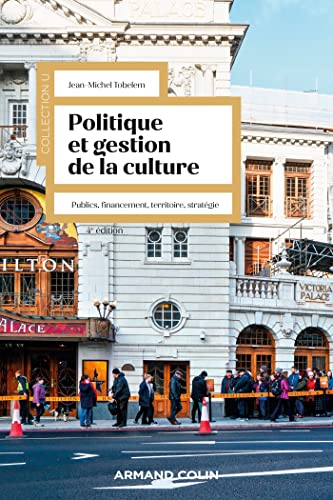 Politique et gestion de la culture : publics, financement, territoire, stratégie par
Politique et gestion de la culture : publics, financement, territoire, stratégie par 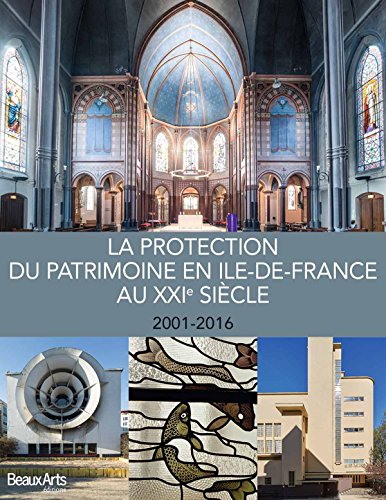 La protection du patrimoine en Ile-de-France au XXIe siècle par
La protection du patrimoine en Ile-de-France au XXIe siècle par 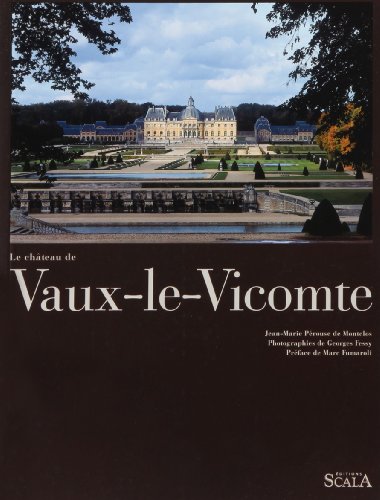 Le château de Vaux-le-Vicomte par
Le château de Vaux-le-Vicomte par 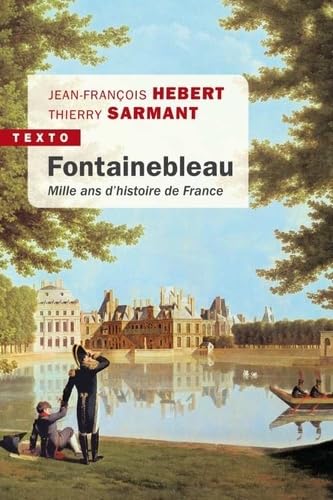 Fontainebleau : mille ans d’histoire de France par
Fontainebleau : mille ans d’histoire de France par 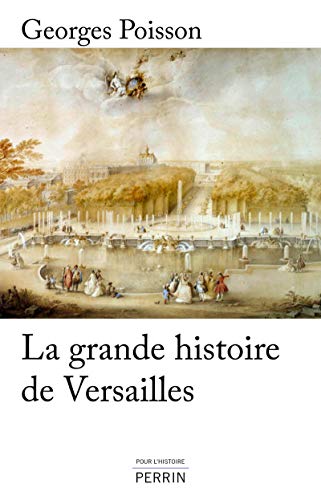 La grande histoire de Versailles par
La grande histoire de Versailles par  Hubert Robert, 1733-1808 : un peintre visionnaire. Somogy éditions d'art, Louvre éditions, 2016
Hubert Robert, 1733-1808 : un peintre visionnaire. Somogy éditions d'art, Louvre éditions, 2016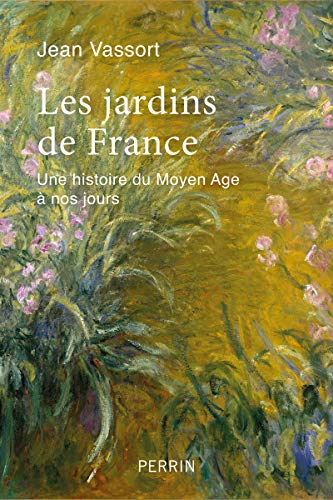 Les jardins de France : une histoire du Moyen Âge à nos jours par
Les jardins de France : une histoire du Moyen Âge à nos jours par